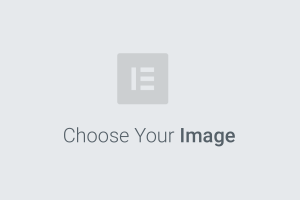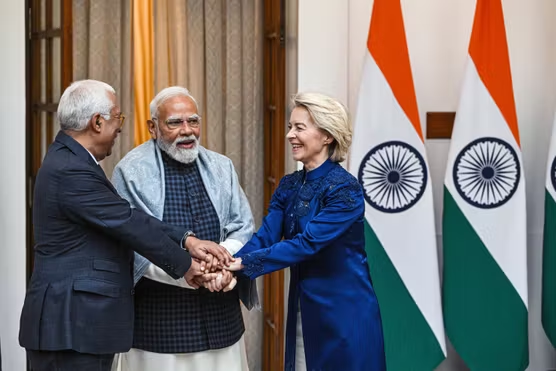À quelques semaines du sommet du G20 prévu les 22 et 23 novembre 2025 à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa insiste sur l’importance de réussir une présidence historique : pour la première fois, un pays africain préside le G20. Malgré cette ambition, son initiative est marquée par des tensions diplomatiques, des critiques intérieures et des défis logistiques majeurs.
Un agenda “Global Sud” très affirmé
Ramaphosa porte une vision claire pour le G20 : promouvoir les priorités du “Sud global”, avec comme leitmotiv les principes de “solidarité, égalité et durabilité”.
Selon lui, cette présidence est une opportunité unique de faire avancer des réformes profondes dans les institutions financières mondiales, notamment le FMI et la Banque mondiale, afin d’alléger le fardeau de la dette des pays en développement.
Il appelle aussi à un soutien accru pour la transition énergétique verte dans les pays pauvres et à une redistribution équitable des ressources naturelles : “les investissements ne doivent pas créer une nouvelle dépendance, mais ouvrir des voies de développement durable”, a-t-il déclaré récemment.
Dans le cadre de sa stratégie, Ramaphosa a mis en place un comité d’experts indépendants, présidé par le prix Nobel Joseph Stiglitz, chargé d’élaborer un rapport sur les inégalités de richesse à l’échelle mondiale.
Un boycott américain et des divisions géopolitiques
Le pari du président sud-africain est loin d’être sans risque : la présence des États-Unis est en dents de scie. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a boycotté la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg, critiquant le programme axé sur l’“équité, la diversité et le climat” comme “anti‑américain”.
Donald Trump, quant à lui, a confirmé que les États-Unis ne participeront pas au sommet des chefs d’État, dénonçant notamment des politiques qu’il juge hostiles vis-à-vis des Afrikaners et des positions sud-africaines à l’international.
Ramaphosa a répliqué en minimisant l’absence : “Le G20 va se tenir, leurs absences sont leur perte”, a-t-il déclaré, affirmant que des “décisions fondamentales” seront prises, en dépit des divergences.
Cette fracture avec Washington soulève une question : le G20 sans les États-Unis peut-il réellement peser ? Certains analystes estiment que l’absence de Washington affaiblit le pouvoir de réforme sur les institutions financières, où l’influence américaine reste déterminante.
Des critiques domestiques : l’Afrique du Sud face à ses propres contradictions
Ramaphosa joue un message ambitieux à l’international, mais doit aussi faire face à des critiques sur son propre terrain. Les partis d’opposition et groupes civiques dénoncent un paradoxe : alors que le G20 doit se tenir à Gauteng, province censée briller, celle-ci est en proie à des pannes d’électricité, des pénuries d’eau, des routes dégradées et des déchets non ramassés.
Pour Ramaphosa, ces critiques sont gérables. Il assure que les préparatifs avancent bien plus de 130 réunions préparatoires ont déjà eu lieu, selon lui.
Il défend également une vision d’investissement transformateur pour l’Afrique : les financements ne doivent pas simplement créer de nouvelles dépendances, mais favoriser un développement local stable et durable.
Un coup de force diplomatique et symbolique
Le G20 sud-africain est plus qu’un simple sommet : c’est un coup diplomatique. En plaçant l’Afrique au centre du débat mondial, Ramaphosa cherche à redéfinir les priorités du G20, en faire un levier de justice économique et climatique, et affirmer le leadership de Pretoria sur la scène internationale.
Mais le défi reste double. D’un côté, réussir un G20 “du Sud” sans la pleine participation des grandes puissances notamment les États-Unis est une entreprise risquée. De l’autre, l’écart entre la rhétorique ambitieuse et les réalités locales (crises d’infrastructure, pauvreté, inégalités) pourrait miner la crédibilité de l’opération.
Si Ramaphosa parvient à une déclaration robuste, à des engagements financiers concrets et à des réformes multilatérales crédibles, ce G20 pourrait marquer un tournant pour les pays en développement. Sinon, il pourrait être perçu comme une opération de prestige porteuse de promesses difficiles à tenir.