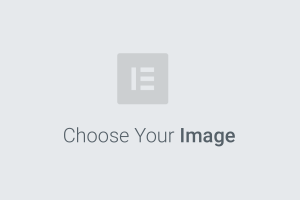Un projet ambitieux et controversé
En septembre 2025, le gouvernement suédois a dévoilé son « kulturkanon », un canon culturel national rassemblant 109 références jugées essentielles pour définir l’identité et le patrimoine de la Suède. Ce projet, porté par la ministre de la Culture Parisa Liljestrand, vise à donner aux citoyens, mais aussi aux nouveaux arrivants, une base commune de repères culturels allant de la littérature aux arts, en passant par l’architecture, le design et la science.
Parmi les œuvres et symboles sélectionnés : Pippi Långstrump d’Astrid Lindgren, l’univers cinématographique d’Ingmar Bergman, le Prix Nobel, mais aussi le design d’IKEA, devenu emblématique à l’échelle mondiale.
Une vision sélective du patrimoine
Cependant, ce canon repose sur une règle : seules les œuvres ou institutions vieilles d’au moins 50 ans peuvent y figurer. Cela exclut de fait des piliers récents de la culture suédoise, comme ABBA, dont le premier album date de 1973 mais dont la consécration mondiale a eu lieu après 1975, ou encore des auteurs contemporains, cinéastes, musiciens ou créateurs qui ont marqué l’identité du pays ces dernières décennies.
Cette exclusion a déclenché une vague de critiques :
- Des voix dénoncent un instrument politique et conservateur, qui figerait une identité suédoise « idéale » en négligeant la diversité contemporaine.
- D’autres regrettent l’absence de voix féminines et immigrées récentes, pourtant centrales dans l’art et la société suédoises actuelles.
- À l’inverse, ses défenseurs estiment qu’un tel canon renforce la cohésion sociale et sert d’outil pédagogique, notamment dans l’intégration des migrants.
Un outil d’intégration… ou un miroir déformant ?
Selon le gouvernement, l’objectif affiché est d’offrir une base commune permettant à chacun de comprendre les références culturelles qui ont façonné la société suédoise. L’idée est aussi de renforcer la transmission de ce patrimoine dans les écoles et dans la société civile.
Mais les critiques, y compris d’intellectuels et d’artistes, rappellent que la culture est un processus vivant, en constante évolution, et que la réduire à une liste fermée revient à figer une identité nationale, risquant de marginaliser des pans entiers de la création contemporaine.
Une tradition nordique
La Suède n’est pas la première à instaurer un tel canon : le Danemark l’a fait dès 2006, la Norvège et l’Islande ont également réfléchi à des listes similaires. Ces initiatives, toujours débattues, oscillent entre volonté pédagogique et controverses politiques.
Un débat qui dépasse la culture
Le « kulturkanon » illustre un tournant idéologique en Suède, où les questions de culture et d’identité nationale occupent une place croissante dans le débat public. À l’heure où le pays se confronte à des enjeux de migration, de diversité et de mondialisation, cette liste n’est pas seulement un inventaire patrimonial : elle est devenue le symbole d’un bras de fer entre mémoire et modernité, héritage et ouverture.